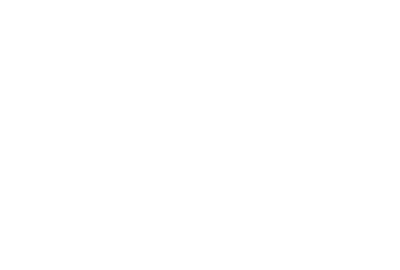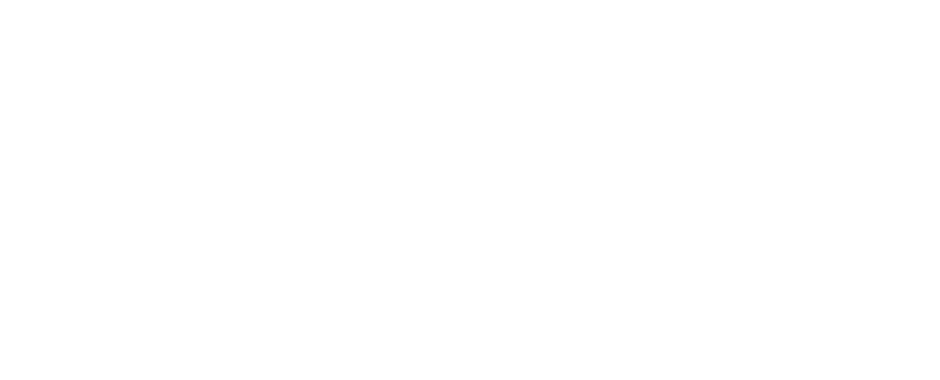"L’emplacement de cet équipement répond à une logique de sécurisation d’un itinéraire particulièrement accidentogène", indique la Préfecture du Doubs. Sur la période 2014 – 2018, sur cette section de RD67B pourtant courte (environ six kilomètres), Trois personnes y ont perdu la vie auxquelles s’ajoutent cinq blessés dont deux hospitalisés.
La dégradation de ce radar "est donc particulièrement regrettable", pour la Préfecture : il est rappelé qu’à l’échelle nationale, en 2018, la vitesse excessive ou inadaptée aux circonstances est présente dans 27% des accidents.
Pour rappel, vandaliser un radar est un délit, qui relève des articles 322-1 et article 322-2 du code pénal. Il entraîne donc une inscription au casier judiciaire, "ce qui peut fortement compliquer la vie de la personne condamnée", est-il souligné.
Dans tous les cas de dégradation, une plainte est déposée et les auteurs sont systématiquement recherchés. L'État se porte ainsi très fréquemment partie civile et obtient, à la charge des délinquants, des dommages et intérêts, qui couvrent les dépenses engagées pour les réparations.
- Pour avoir affiché des autocollants, fait des graffitis, occulté ou bâché les vitres d’un radar : l’auteur des dégradations risque jusqu’à 15 000 euros d’amende et une peine d’intérêt général ;
- Pour avoir détruit ou endommagé un radar (incendie, vol, explosion) : l’auteur des dégradations risque jusqu’à 75 000 euros d’amende et cinq ans d’emprisonnement ;
- Si l’action a été menée par un groupe de personne, ou un individu masqué, la peine est encore plus lourde : jusqu’à 100 000 euros d’amende et sept ans d’emprisonnement.
En 2018, 79,1% des recettes issues des radars automatiques ont été affectées à la mission de lutte contre l’insécurité routière, par l’intermédiaire de la Délégation à la Sécurité Routière (DSR), de l’Agence de financement des infrastructures de transport en France (AFITF) et des collectivités territoriales. La part des amendes issues du contrôle automatisé qui contribue au désendettement de l’État est de 20,9%.
L’État a mobilisé en 2017 plus de 3,7 milliards d’euros à la politique de sécurité routière et le coût total des accidents corporels survenus en 2016 est estimé, quant à lui, à 39,7 milliards d’euros.