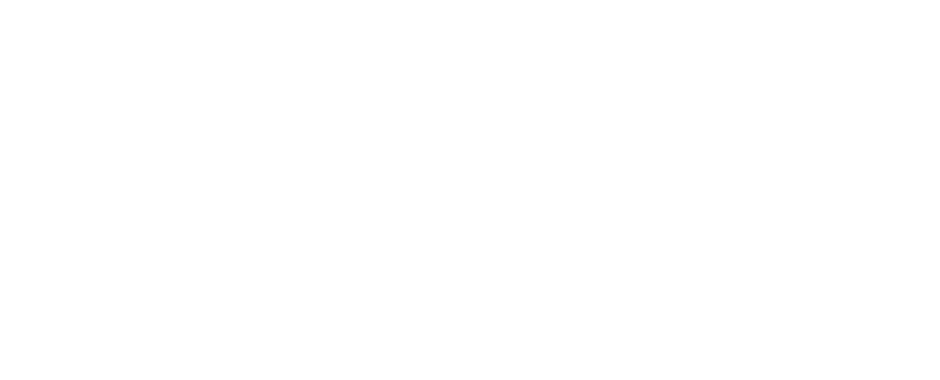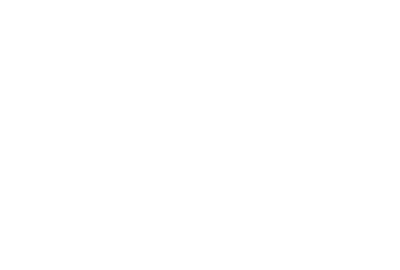En principe, le salarié est libre de choisir sa tenue vestimentaire sur son lieu de travail. Le Code du travail, via son article L. 1121-1, énonce que : ”Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché”.
Autrement dit, un employeur peut restreindre cette liberté, à condition que la restriction soit justifiée et proportionnée. Par exemple, des impératifs d’hygiène, de sécurité ou d’image peuvent motiver certaines exigences.
L’avis du Défenseur des droits : éviter les discriminations
Le Défenseur des droits appelle les employeurs à porter une attention particulière aux questions d’apparence physique et de code vestimentaire. Il souligne que : ”Les codes vestimentaires doivent être justifiés par la nature des postes concernés et légitimes et proportionnés au but recherché. Ils peuvent s’appuyer sur des mesures d’hygiène et de sécurité ou peuvent répondre, dans certaines limites, à des considérations d’image ou d’identification”.
Il ajoute que certaines pratiques, autrefois jugées normales, peuvent aujourd’hui être perçues comme discriminatoires. L'évolution des mentalités et des tendances vestimentaires pousse à revoir les règles internes, tout en garantissant une égalité de traitement entre les femmes et les hommes.
Une jurisprudence nuancée
La Cour de cassation a apporté plusieurs précisions importantes concernant la tenue au travail. Dans un arrêt du 28 mai 2023, elle a jugé que : ”La liberté de se vêtir à sa guise ne constitue pas une liberté fondamentale garantie par le Code du travail”.
Ainsi, des restrictions peuvent être légalement imposées lorsqu’elles répondent à des nécessités professionnelles, notamment :
- L’hygiène, comme dans le cas d’un ouvrier charcutier dont la tenue négligée avait été critiquée par des clients ;
- La sécurité, où l’employeur peut imposer des équipements ou vêtements spécifiques pour protéger les salariés ;
- La décence, par exemple le cas d’une aide-comptable portant un chemisier transparent sans dessous, jugé ”de nature à susciter un trouble dans l’entreprise” (Cour de cassation, arrêt n° 82-43.824 du 22 juillet 1986) ;
- L’image de l’entreprise, particulièrement si le salarié est en contact avec la clientèle.
De plus, dans un arrêt du 11 janvier 2012 (n° 10-28.213), la Cour de cassation a statué sur le cas d’un salarié refusant de retirer ses boucles d’oreilles en service dans un restaurant. L’affaire illustre la manière dont les règles vestimentaires doivent être appréciées au regard du poste occupé.
Des règles à formaliser et à expliquer
Pour le Défenseur des droits, une interdiction de tenue n’est acceptable que si elle est motivée, pertinente et proportionnée. Il recommande aux employeurs de : ”Concilier leurs besoins opérationnels et le respect des droits individuels, à travers une communication claire (par exemple en impliquant les employés dans l’élaboration du code vestimentaire)”.