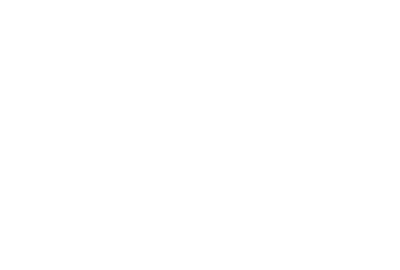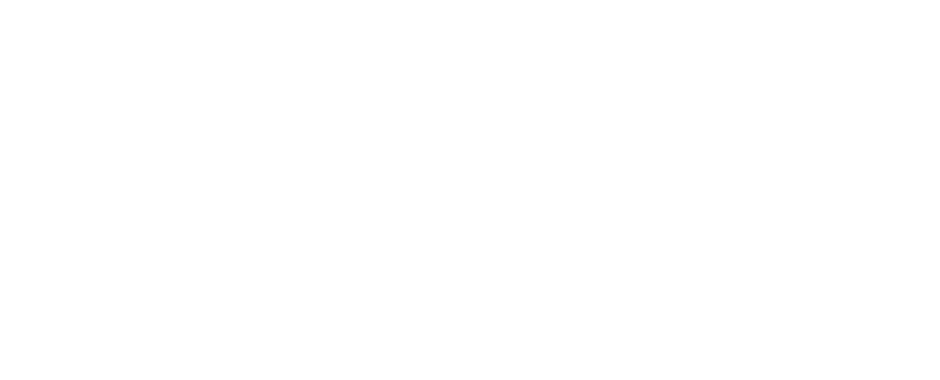"À l’époque pendant laquelle j’ai fait de la médecine légale, c’était une spécialité complémentaire", se souvient le Dr Martin. Après avoir commencé un parcours en psychiatrie puis en pédopsychiatrie, elle découvre la discipline qui la marquera durablement : "C’est en voyant l’intérêt en psychiatrie, le lien avec la justice, le droit médical, et la prise en charge des auteurs et victimes de violences que je me suis rendue compte que mon intérêt portait vers la médecine légale." Un stage pendant l’internat confirmera cette intuition. À noter qu'aujourd’hui, les internes choisissent la médecine légale comme spécialité à part entière.
Un service aux multiples missions
Le service de médecine légale du CHU de Besançon compte 19 professionnels titulaires, sans compter les étudiants et stagiaires. Il regroupe plusieurs entités dont le Centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles (Criavs), les soins somatiques et psychiatriques à la maison d’arrêt de Besançon, et une unité dédiée à la prise en charge des violences faites aux femmes, en lien avec la future Maison des femmes et santé.
Une mosaïque de missions qui illustre la diversité du champ médico-légal : "C’est une activité très variée, au carrefour du soin, de la prévention et de la justice", nous précise Dr Martin.
Des journées sans routine
Dans ce service, aucune journée ne se ressemble. "On a une organisation bien rôdée : on sait quand on arrive le matin quelles seront nos tâches, qui sera de permanence le soir ou le week-end", nous explique la cheffe du service. Mais le métier reste rythmé par l’imprévu. "Le médecin d’astreinte peut autant examiner des personnes en garde à vue, que des victimes pour lesquelles la justice a besoin d’un avis médico-légal en urgence, ou encore aller faire une levée de corps. L’activité dépend de "l’actualité judiciaire du moment" : imprévisible et toujours singulière.

Entre rigueur scientifique et solidarité d’équipe
L’image du médecin légiste solitaire dans une morgue froide, popularisée par les séries télévisées, est loin de la réalité, comme nous le décrit Dr Martin, "le médecin légiste, c’est d’abord un maillon de la chaîne judiciaire, mais aussi un maillon d’une équipe." Elle décrit un travail collaboratif avec les agents de la chambre mortuaire, les radiologues en imagerie post-mortem, ou encore les laboratoires spécialisés.
La confrontation quotidienne à la mort et à la violence demande un équilibre subtil. "Être en contact avec la mort, c’est éprouvant, surtout lors d’autopsies de sujets très jeunes. Mais le travail en équipe, l’humour et la bonne entente créent un climat de soutien", souligne-t-elle. Et surtout, rappelle-t-elle, "il y a un accompagnement humaniste et éthique : les familles viennent visiter les défunts, il y a une réflexion constante sur le sens de ce qu’on fait."
"C’est vraiment le médecin de la violence"
Derrière la fascination pour les autopsies, le Dr Martin insiste : "Le médecin légiste, c’est le médecin qui s’occupe de la violence en général, que les personnes soient vivantes ou décédées." Cette spécialité englobe toutes les formes de violence – conjugale, sexuelle, psychologique, ou auto-infligée : "Nous sommes les médecins de la violence à tous ses stades, dans une dimension à la fois judiciaire et scientifique, mais aussi d’accompagnement", ajoute-t-elle.
Le service est ainsi fortement impliqué dans les Unités d’accueil pédiatrique des enfants en danger (UAPED) et dans la future Maison des femmes, autant de structures visant à assurer un parcours de soins cohérent pour les victimes.
Violences faites aux femmes : un quart des examens médico-légaux
La médecine légale, autrefois dominée par les hommes, s’est largement féminisée. Au CHU de Besançon, sur six médecins légistes, on compte un homme. L’équipe est jeune, avec une moyenne d’âge autour de 40 ans. "La féminisation de la médecine est générale et la médecine légale n’y échappe pas", constate Elisabeth Martin. Pour autant, elle souligne que cette évolution ne modifie pas la nature du métier : "Le rôle du médecin légiste, quelle que soit la problématique sociétale, ne change pas et ne doit pas changer. Nous ne sommes pas dans la peau et dans la fonction d’un porte-parole de victime par exemple."
Au sein du service de médecine légale du CHU de Besançon, la prise en charge des femmes victimes de violences occupe une place importante. "Les femmes victimes de violences, conjugales ou sexuelles, représentent depuis 2019 entre 20 et 25 % des examens réalisés auprès de vivants", précise le Dr Elisabeth Martin. Une proportion significative, reflet d’une réalité sociale encore préoccupante. Selon elle, cette hausse s’est amorcée bien avant le mouvement #MeToo : "l’augmentation, on l’a vécue entre 2015 et 2019, avant la libération de la parole. Elle est liée à une évolution du traitement judiciaire, avec une attention accrue des magistrats et des enquêteurs. On a senti qu’on nous adressait de manière plus systématique ces femmes et qu’il y avait un traitement judiciaire qui évoluait et qui mettait un focus sur ces problématiques-là, c’est comme ça qu’on a senti le mouvement", explique-t-elle.
Le service s’est ainsi doté d’une expertise spécifique dans l’évaluation de ces situations complexes, notamment de harcèlement ou de violences psychologiques. Cette implication se traduit par une collaboration étroite avec les unités de prise en charge des victimes et la future Maison des femmes. Elisabeth Martin explique qu'"un service qui rencontre énormément de victimes de violences conjugales a développé une expertise sur cette thématique oui, ça implique énormément, dans des échanges, des formations, et dans la recherche d’outils pour mieux accompagner les victimes et pour mieux faire cet éclairage que l’on doit faire auprès de la justice."
Une implication totale, mais toujours maîtrisée
Le Dr Martin l’admet : certaines affaires peuvent "habiter" les médecins légistes. "On peut être très accaparé par certains dossiers criminels, surtout quand on y est impliqué à plusieurs étapes de la procédure", nous confie-t-elle. Mais la temporalité du métier aide à préserver un équilibre : "Une fois que le dossier est géré, qu’on est passé aux assises, quelque chose se referme." Même après des années, et bon nombre d'affaires sensibles, elle n’a "jamais remis en question" son choix de carrière.

Entre science et humanité
Dans les couloirs du service médico-légal du CHU de Besançon, on parle certes de prélèvements, d’autopsies et d’expertises, mais aussi d’écoute, d’accompagnement et de sens.
"La médecine légale, c’est une discipline qui interroge profondément l’humain. C’est ce qui la rend, malgré tout, soutenable", conclut le Dr Martin,